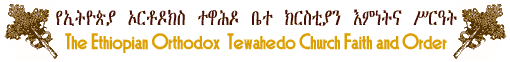
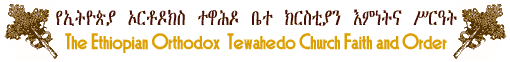

LA POSITION DES EGLISES NON-CHALCEDONIENNES [1]
Mgr TERENIG (Poladian)
I. LES CONTROVERSES CHRISTOLOGIQUES
La période allant du IVe au VIe siècle fut celle des grandes controverses christologiques qui agitèrent et, finalement, divisèrent, l'Eglise chrétienne. L'origine de ces controverses est assez simple. Le Christ est la tête de l'Eglise; pour tout chrétien, Il est Seigneur et, dans tout culte chrétien, Il est adoré comme divin Seigneur. Mais comment concilier cette seigneurie du Christ avec la souveraineté de Dieu? Et si le Christ est divin, comment concilier sa divinité avec son humanité? Quelle est la nature de la divinité - une, indivisible, éternelle et ineffable, mais s'identifiant cependant au Seigneur de l'Eglise adorante? Comment définir la véritable nature de ce Seigneur, d'une part humain par la forme revêtue, la condition et le partage des souffrances de l'homme; d'autre part divin, puisqu' Il partage l'essence de l'Eternel?
De nombreuses solutions furent suggérées. Il n'est nullement besoin de prétendre que les interprétations proposées ne le furent pas en toute sincérité, et non dans le but d'apporter une solution raisonnable à ce que la communauté ressentait comme un problème. Evidemment, toutes les solutions proposées ne pouvaient être acceptées. L'Eglise devait choisir le plus raisonnable, et l'adopter comme son interprétation officielle du problème. La solution adoptée ne fit pas l'unanimité de tous les esprits et, ici et là, surgirent des groupes qui préférèrent recevoir l'une des autres solutions suggérées. Ces groupes étaient les hérétiques et, selon l'habitude de l'époque, on les persécuta et les força ainsi à s'organiser eux-mêmes en partis dissidents.
La plus considérable, la plus importante controverse christologique que l'Eglise chrétienne affronta durant le IVe siècle fut l'arianisme. Le père de cette hérésie était Arius, prêtre de la cité d'Alexandrie après l'an 313. En tant que disciple d'Origène, il représentait l'enseignement du grand Alexandrin, pour lequel le Christ était un être créé. Dans cette perspective, bien que le Christ fût le créateur du monde, il était lui-même une créature de Dieu et, par conséquent, n'était pas vraiment divin: le Père seul, dès lors, était Dieu.
Aussi, lui seul était-il inengendré, éternel, parfait et sans changement. Il créa le monde par l'intermédiaire d'un agent, le Logos. Le Fils de Dieu préexiste à toute créature, tel un intermédiaire entre Dieu et le monde, l'image parfaite du Père, ainsi susceptible d'être dénommé par métaphore Dieu, Logos et Sagesse.
Mais, par ailleurs, il est lui-même une créature, la première création de Dieu, tirée du néant par la volonté du Père avant tout temps concevable. Aussi n'est-il pas éternel mais eut un commencement avant lequel il n'était point.
Afin de mettre un terme à ces disputes christologiques et de faire l'unité de l'Eglise chrétienne dans son entier, l'empereur Constantin le Grand convoqua tous les évêques de l'empire qui se rassemblèrent à Nicée, en 325. Ce fut le premier concile oecuménique, qui condamna et bannit Arius et quelques-uns de ses disciples.
En outre, le concile formula un symbole, connu sous le nom de Credo de Nicée, dans lequel il définit que le Christ est pleinement Dieu et "s'est fait homme". Sur cette base s'éleva ensuite la question des relations entre le divin et l'humain en lui, mais le credo nicéen se taisait sur ce problème. Il était possible d'envisager la question christologique sous deux angles. On pouvait insister sur l'unité du Christ afin d'impliquer une union de son humanité avec la divinité; ou bien maintenir l'intégrité de chaque élément, le divin et l'humain, de façon à reconnaître en lui deux êtres séparés. Les deux tendances se manifestèrent dans la controverse, inclinant vers la première les théologiens les plus avertis d'Alexandrie, et faisant dériver la seconde des enseignements de l'école d'Antioche.
Le premier et l'un des plus capables de ceux qui s'essayèrent à une profonde discussion des rapports entre l'humain et le divin en Christ fut Apollinaire, évêque de Laodicée en Syrie (vers 360). Selon lui, l’œuvre du Christ pour les hommes consistait en la transformation de notre mortalité pécheresse en une divine et bienheureuse immortalité. Cette oeuvre de salut, pensait Apollinaire, ne pouvait trouver son achèvement que si le Christ était complètement et parfaitement divin. Mais comment, raisonnait-il, le Christ pouvait-il se composer d'un homme parfait uni à un Dieu complet?
N'était-ce pas affirmer deux Fils -l'un éternel et l'autre par adoption? La meilleure solution lui sembla d'avancer qu'en Jésus la place de l'âme était tenue par le Logos, le corps seulement étant humain. Par la suite, il soutint que Jésus avait le corps et l'âme animale d'un homme, mais que l'esprit de sagesse qui reposait en lui était le Logos. De telles opinions niaient réellement la véritable humanité du Christ, et appelèrent promptement la condamnation de leur auteur au second concile oecuménique, en 381.
A Apollinaire, l'école d'Antioche opposait son chef qui, dans la dernière période, était Diodore (Uvers 390). C'était un prêtre d'Antioche, devenu, de 378 à sa mort, évêque de Tarse. Dans sa tentative de donner une véritable valeur à l'humanité du Christ, Diodore avança qu'il y avait deux personnes en Christ, unies moralement plutôt que selon l'essence. L'incarnation était alors la descente du Logos dans un homme parfait, comme de Dieu dans un temple.
Théodore de Mopsueste et Nestorius étaient au nombre des disciples de Diodore. Théodore, originaire d'Antioche, était un grand exégète et un théologien renommé de l'école d'Antioche. Ses théories doctrinales étaient pratiquement identiques à celles de Diodore. Nestorius, prêtre et moine d'Antioche, tenu là-bas en haute estime pour ses dons de prédicateur, devint patriarche de Constantinople en 428. Il enseignait que Marie n'était Mère de Dieu qu'en ce qu'elle avait enfanté l'homme assumé par Dieu.
Il y avait donc deux Fils, dont l'un -le fils de Marie, était Fils de Dieu par grâce et non par nature, si bien que Marie n'était pas, excepté en titre, la Mère de Dieu. Une créature, disait-il, n'a pas produit Celui qui est incréé; le Père n'a pas engendré de la Vierge un enfant qui serait Dieu le Verbe. «A cause de ce qui est caché, j'adore ce qui apparaît».1
A Nestorius s'opposa Cyrille, le patriarche d'Alexandrie (412-444) qui, suivant la tradition alexandrine, vit en Christ la pleine union des natures humaine et divine. Sa formule fameuse, "une seule nature incarnée de Dieu le Verbe", signifie que le Logos prit chair. se revêtant lui-même de l'humanité, le Seigneur étant un de deux natures, et ayant une personnalité une. Pour Cyrille, c'était par conséquent Dieu fait chair qui était né, qui mourut, que nous partageons à la Cène mystique, et dont la déification de l'humanité est la preuve, tout en signifiant que nous aussi serons faits participants de la nature divine. L'humanité et la divinité sont unies en Christ harmonieusement, sans confusion ni changement.
Cyrille vit les théories hérétiques pointant dans les enseignements de Nestorius. Il écrivit promptement aux moines égyptiens, défendant la doctrine selon laquelle la Vierge Marie était la Mère de Dieu, la Théotokos. Bientôt s'ensuivit un échange de lettres critiques entre Cyrille, Nestorius et le pape Célestin 1er (422-432). Ce dernier se rangea du côté d'Alexandrie. Cyrille en appela à l'empereur Théodose II, en lui représentant que les théories de Nestorius ruinaient tout fondement d'orthodoxie et de salut. Un troisième concile oecuménique fut convoqué en 431 à Ephèse, où Nestorius et ses erreurs furent condamnés; mais ceci ne mit pas un terme aux disputes théologiques et aux querelles.
Eutychès, un archimandrite âgé de Constantinople, enseigna que Jésus avait deux natures avant l'incarnation, et une seule après l'union de la divine avec l'humaine, faisant ainsi disparaître l'humanité du Christ dans la divinité. Il fut condamné par un concile local réuni à Constantinople en 448 par le patriarche Flavien. Cependant, Dioscore, patriarche . d'Alexandrie, considéra cette condamnation comme un retour au nestorianisme, et prit activement la défense d'Eutychès.
A sa demande, l'empereur Théodose II appela un concile général à se réunir à Ephèse, en août 449, où Flavien et les autres évêques furent déposés et Nestorius condamné. Le pape Léon 1er (440-461) rejeta sans tarder ce synode. II souhaitait tenir un nouveau concile en Italie, où son influence aurait été forte, mais ce dessein n'entrait pas dans les vues de la politique impériale. Le nouveau concile général se tint à Chalcédoine, non loin de Constantinople, sur la rive opposée, en 451.
Un credo, qui y était brandi, fut ratifié par le concile. Le résultat fut un véritable triomphe occidental 2. Le Tome de Léon 3, qui y fut accepté, s'accordait avec la doctrine des deux natures en Christ, chacune préservant sa propre propriété. Quelques-uns des évêques présents rejetèrent la formule des "deux natures", la ressentant directement comme nestorienne et, plus encore, comme une innovation; ils furent dénommés monophysites. Ceux qui soutinrent le Credo de Chalcédoine sont appelés dyophysites-chalcédoniens. Les haines nationales, les animosités politiques, les rivalités patriarcales et les jalousies personnelles contribuèrent toutes à exaspérer les différences christologiques qui déchirèrent définitivement l'Eglise à partir du Ve siècle.
Les Eglises monophysites 4 rejetèrent les décrets de Chalcédoine, condamnèrent les hérésies arienne, eutychienne et nestorienne, et s'en tinrent fermement aux décisions des trois premiers conciles oecuméniques, acceptées par toutes les Eglises chrétiennes. En procédant ainsi, elles se tinrent à l'écart des rivalités ecclésiastiques et des tendances doctrinales des Eglises latine et grecque.
II. UNE CRITIQUE DE LA FORMULE «DES DEUX NATURES»
La principale cause de toutes les discussions théologiques et de la division entre les Monophysites et les Dyophysites est la définition chalcédonienne des deux natures. Les Eglises monophysites ne l'ont jamais acceptée, considérant qu'elle contredisait la profession de foi du concile d'Ephèse, où l'on avait défini une union parfaite de la divinité et de l'humanité du Christ contre l'hérésie nestorienne.
Le concile de Chalcédoine ratifia la doctrine contenue dans le Tome de Léon, qui parle distinctement de l'une et de l'autre nature du Christ. Il insista aussi sur le fait que «chaque nature en effet tient sans défaut ce qui lui est propre», «le Verbe opérant ce qui est du Verbe, et la chair exécutant ce qui est de la chair». Ce concept de la dualité des natures, chacune préservant son propre caractère ou particularité, et agissant en conséquence, est considéré par les Eglises monophysites comme nestorien ou tendant au nestorianisme, sans excepter non plus les décisions du concile de Chalcédoine. Illustrons le point en question.
Nestorius, dans son principal traité sur la foi, dit: «Je confesse que Dieu le Verbe a deux natures sans changement ni altération; l'une est celle du vrai Dieu de vrai Dieu, l'autre de l'homme parfait, fils de David et d'Abraham" 5. Léon écrit dans son Tome: «Je le confesse comme Dieu, parce qu'au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu; comme homme, parce que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous» 6.
Nestorius écrit: «Dieu le Verbe ne fut pas enveloppé dans le suaire par J oseph (d'Arimathie), mais (seulement) son corps»7. Léon écrit: «Une nature brille dans les miracles, l'autre succombe aux outrages»8.
Nestorius écrit: «En Christ, je discerne deux natures, mais une seule dignité»9. Léon écrit: «Avoir faim, avoir soif, être fatigué et dormir est évidemment de l'homme; mais avec cinq pains nourrir cinq mille hommes, donner à la Samaritaine l'eau vive qui permet à celui qui en boit de n'avoir plus jamais soif; marcher sur le dos de la mer sans que les pieds ne s'enfoncent; réprimander la tempête et rabattre l'orgueil de la mer - sans aucun doute, cela est de Dieu»10.
Le lecteur voit maintenant combien Nestorius et Léon s'accordent quant à la distinction des natures et à la propriété des opérations.
Une étude de l'histoire du dogme du concile de Chalcédoine à nos jours révèle une opposition continue à la soi-disant doctrine "des deux natures". A l'époque moderne, la définition chalcédonienne a fait l'objet de critiques considérables.
Le professeur Harnack dit :
«Le monophysisme, qui s'en tient à ce qu’en Christ il y a une nature composée ou la nature divine incarnée à partir de deux natures parfaites, la divinité et l'humanité. et qui n'a rien à faire avec l'idée d’une volonté libre dans le Christ, est dogmatiquement conséquent»11.
Et encore: «En "venant ensemble", chaque nature continue à exister dans sa propre façon d'être; la divinité n'a pas absorbé l'humanité et l'humanité n'a pas été exaltée au rang de la divinité, mais les natures humaine et divine sont simplement unies en la personne du Rédempteur et. par conséquent seulement par cet intermédiaire et en un individu. Aucun pieux Grec, ayant eu Athanase et Cyrille pour docteurs, ne pouvait reconnaître en cela la vraie doctrine»12.
Et encore: «Le vrai mystère, au contraire, résidait dans l'union substantielle des natures elles-mêmes. Il fut sérieusement compromis en étant exclu de cet aspect et lorsqu'en lieu et place de l'union fut élevée à la hauteur de mystère de la foi une autre conception impliquant en même temps un état de séparation. Le vrai mystère fut ainsi écarté par un pseudo-mystère qui, en vérité, ne permit plus à la théologie d'atteindre l'union effective et parfaite»13.
Ceci signifie qu'à Chalcédoine aucune union réelle ne fut obtenue. Les natures humaine et divine furent comprises comme des entités séparées, non réellement unies. En fait, Chalcédoine échoua dans sa tentative de rendre compte du Christ un, tel que les théologiens orientaux l'avaient toujours exigé.
Schweitzer, désirant se débarrasser de l'ancienne christologie avec la doctrine de ses "deux natures" et de ses postulats contradictoires, s'écrie :
«Quand, à Chalcédoine. l'Occident l'emporta sur l'Orient, sa doctrine des deux natures amena la dissolution de l'unité de la personne et supprima ainsi la dernière possibilité d'un retour au Jésus historique. La contradiction de soi fut érigée en principe. Mais la nature humaine fut admise afin de préserver, en apparence, les droits de l'histoire. Ainsi, par une duperie. la formule [des deux natures] retint la Vie prisonnière et empêcha les chefs de la Réforme d’embrasser l'idée d'un retour au Jésus historique.
Ce dogme devait être brisé avant que les hommes puissent une fois de plus partir à la quête du Jésus historique, avant qu'ils puissent même concevoir la pensée de son existence. Que le Jésus de l’histoire soit différent du Jésus-Christ de la doctrine des deux natures nous semble maintenant aller de soi. Nous pouvons, à présent, difficilement imaginer la longue crise durant laquelle vint à naître la conception historique de la vie de Jésus. Et même quand il fut un jour rappelé à la vie, il était encore, comme Lazare, enveloppé des pieds à la tête du linceul. le linceul du dogme de la double nature»14.
Un autre phénomène frappant, dans la pensée chrétienne moderne, est la critique générale à laquelle a été soumise la doctrine des deux natures par des savants fidèles aux enseignements de l'Eglise, mais dont la définition de Chalcédoine n'exprime pas la foi. Non que leur foi soit en question, mais la formulation dogmatique chalcédonienne échoue à exprimer le mode de leur pensée. Dykes donne l'aperçu suivant de ce que la doctrine des deux natures est supposée enseigner :
« Un être, dit-il, qui unit de façon inexplicable les propriétés divines avec les humaines et dont, par conséquent, on peut faire des assertions contradictoires. dont la personne seule est divine, alors que ses deux natures ont une relation indéterminée de l’une à l'autre. Ce n'est pas un schéma propre à satisfaire la tête et le cœur. Mais c'est le squelette nu d'un dogme en lequel on ne peut aisément reconnaître ni le Jésus des Evangiles ni le Christ du culte de l'Eglise»15.
Mackintosh, dans son ouvrage intitulé La doctrine de la personne du Christ, voit le principal défaut de la christologie traditionnelle dans son insistance sur la doctrine des "deux natures". Il dit :
«D'abord, la doctrine des deux natures dans sa forme traditionnelle introduit dans la vie du Christ un incroyable et total dualisme. Au lieu de cette unité parfaite que laisse de lui chaque impression, le tout est partagé soigneusement par la fissure de la distinction. A n'en pas douter, il est divisé contre lui-même. Il a toujours été perçu qu'un dualisme de cette sorte, pris au sérieux, annulait la pensée même de la Rédemption par la manifestation de Dieu dans la chair .
L'alternance du divin et de l'humain vicie la vérité de l'incarnation. La simplicité et la cohérence de tout ce que le Christ fut et fit s'évanouit, car Dieu ne vit pas, après tout, une vie humaine. Au contraire, il se tient lui-même à une certaine distance de ses expériences et de ses états. Il n 'y a aucune descente rédemptrice. Le Christ agissait tantôt comme Dieu, dit-on, et souffrait tantôt comme homme. Il ne pouvait pas en être autrement, puisqu'en dernier ressort la déité est impassible...
En bref, la doctrine des deux natures, si elle est prise au sérieux, nous donne deux abstractions au lieu d'une réalité; deux moitiés impuissantes au lieu d'un tout vivant. Elle hypostasie à tort deux aspects d'un seul aspect de vie concret, qui sont si indubitablement réels que, mis à part l'un de l'autre, le tout serait tout à fait autre qu'il n'est. Néanmoins, ces deux aspects ne sont pas en eux-mêmes des substantialités fonctionnant distinctement et susceptibles d'être appréhendées logiquement, ajustées l'une à l'autre ou combinées sous des modes non spirituels.
En second lieu, une difficulté s'élève à propos de la personne en laquelle les deux natures demeurent "inséparablement jointes ensemble" ... Nous ne devons pas commettre l'erreur manifeste de considérer un élément d'une unité vivante comme identique, qu'il appartienne ou non à cette unité. Il est de tradition aujourd'hui d'envisager ainsi la nature humaine (même si ce n'est que provisoirement) séparée de la personnalité. Selon le langage approprié, l'humanité est enhypostasiée. Ce qui constitue la personne est l'Ego du Logos préexistant, qui assume en union avec sa propre hypostase tout cet ensemble brièvement qualifié de "nature humaine" et lui communiquant les propriétés de sa divinité.
Certains docteurs de l'Eglise qui sentaient de vive façon le manque de réalité d'une humanité impersonnelle, s'évertuèrent à rétablir l'équilibre en avançant que l'humanité de notre Seigneur est personnelle séparément ou de son propre chef, avec l'inévitable résultat que l'on en vint finalement à affirmer deux personnalités du seul Christ. Une personnalité double, cependant, n'est pas simplement un concept que nous ne parvenons pas à comprendre; nous en voyons aussi tout à fait bien l'impossibilité. En fait, un être en lequel agissent tantôt Dieu, tantôt l'homme, répugne simultanément à la foi et à l'intellect. Il implique, pour atteindre la divinité, de passer outre à l'humanité et vice versa, les deux étant si entièrement hétérogènes et disparates qu'aucune union véritable n'est concevable»16.
Nous ne voulons pas apporter d'autres références. Les critiques que nous avons mentionnées concernant ce qu'a d'inadéquat et de déplacé la définition de Chalcédoine expriment le jugement de centaines d'étudiants actuels en christologie. Au terme de ce compte-rendu, nous constatons que les penseurs modernes répètent en termes contemporains des objections qui ont été soulevées dès le début contre la christologie chalcédonienne.
Discutons à présent brièvement et franchement nos objections et nos critiques contre la doctrine de Chalcédoine.
Ceux qui acceptent Chalcédoine confessent deux natures, deux volontés, deux opérations en une personne. Le Christ est le médiateur entre Dieu et l'homme. Il y a une nature divine et une humaine; une opération divine et une humaine.
C'étaient la nature et la volonté divines qui accomplissaient les miracles; mais la faim, la soif, les lamentations, la fatigue, le sommeil sont évidemment humains. La nature divine s'éleva, mais l'humaine souffrit et mourut. Une nature était sujette aux nécessités du corps, l'autre était au-dessus des contraintes corporelles; une était passible et l'autre impassible. Mais comment cela se pourrait-il? Puisque celui qui souffrit, qui fut crucifié et mourut sur la croix ne fut jamais un simple homme mais Dieu lui-même qui a assumé notre nature humaine. En ceci nous voyons une double opération dans le Christ, puisque ce ne fut pas le Christ-Dieu qui souffrit, qui fut crucifié, mourut et fut enseveli, mais le Christ-homme; puisque ce ne fut pas le Christ-homme qui accomplit les miracles et triompha de la mort, mais le Christ-Dieu. Bien que la divinité et l'humanité soient unies en une seule personne, les deux natures demeurent cependant distinctement séparées en elle, "chacune accomplissant la fonction qui lui est propre". La difficulté, dans la distinction chalcédonienne des natures, provient de ce que chaque nature en Christ est hypostasiée. En effet, si chaque nature veut et agit selon ce qui lui est propre, il s'ensuit que c'est une hypostase, car une nature non hypostasiée ne peut agir ni exécuter des actes.
Par conséquent, à travers les deux natures hypostasiées, l'on conçoit deux personnes, ce qui est la fraude nestorienne.
Nous pouvons accepter "deux natures" au sens de deux capacités. Le Christ accomplit les miracles et fut glorifié en sa capacité divine, mais souffrit et mourut en sa capacité humaIne.
Par l'union des deux natures, nous ne voulons jamais dissoudre l'une dans l'autre, comme l'eau mélangée avec le vin ou l'or fondu avec l'argent. L'union de Dieu le Verbe avec la chair est semblable à celle de la lumière avec l'air, du feu avec l'or ou de l'âme avec le corps, qui restent sans changement ni altération. Si 1es natures sont séparées distinctement, alors elles ne sont pas unies, car la séparation ne peut pas réaliser l'idée d'union. Par conséquent, si le Verbe ne s'est pas uni sans confusion avec la chair, pourquoi est-il dit de lui qu'«il s'incarna»; et s'il n'était pas uni à l'humanité, pourquoi diton encore qu'il «devint homme», puisque l'incarnation et le fait de se revêtir de la chair se rapportent à l'essence incorporelle?
Les Dyophysites affirment que la nature divine accomplissait des miracles tandis que l'humaine souffrait. De la sorte, les nestoriens ou les chalcédoniens s'enorgueillissent d'avoir préservé la réalité de la divine et la réalité de l'humaine. Une dualité, cependant, n'aurait jamais pu accomplir l'expiation ni racheter l'humanité. En effet, les natures divine et humaine auraient été ainsi mises en contact, mais aucun canal n'aurait permis à la vertu divine de passer dans l'humaine. Dès lors, la divinité n'aurait pas attiré à elle l'humanité et l'humanité n'aurait pas été élevée à la hauteur de la divinité mais, dans la personne du Sauveur, les natures humaine et divine seraient simplement unies.
La doctrine monophysite orthodoxe est qu'une unité parfaite résulta de l'union des deux natures, formant une nature unie, c'est-à-dire une essence, une substance ou existence indissoluble. Il n'y a là aucune confusion entre "physis" et "prosôpon", pas plus qu'on ne voit en ces termes des synonymes, comme les Chalcédoniens, dans leurs polémiques, se sont évertués à le prouver. En Christ, Dieu est présent avec l'homme et fait réellement partie du monde; il permet à la nature humaine de participer à tout ce qui est sien, et participe de même à tout ce qui est nôtre.
L'incarnation, telle que l'ont exposée les théologiens monophysites, est la pénétration mutuelle des deux natures, l'appropriation de la nôtre et la communication de la sienne; en une seule personne, le Fils de Dieu s'est approprié la nature humaine et s'est communiqué lui-même à l'homme. Tout ce qui concerne le Christ devrait être appliqué non à l'une ou l'autre nature, mais à sa personne entière en son unité. Tout ce qui concerne les natures humaine et divine, à savoir la fatigue, la faim, la passion, la résurrection et l'ascension doit être rapporté à cette personne en son unité. La nature humaine possédait réellement la divinité. Les miracles furent accomplis non par le Logos, mais par le Fils de Dieu incarné.
L'humanité du Christ était désormais l'organe à travers lequel il communiquait son esprit. Il est notre vie, notre sauveur, non simplement en tant que Dieu ou par la grâce du Saint-Esprit, mais en nous donnant son Corps glorifié en nourriture.
Nous soutenons fermement l'unicité des deux natures en Christ, et non leur unification comme l'enseignent les Dyophysites; une nature à partir de deux, sans confusion ni division. Si nous désignions séparément la nature humaine du Christ et sa divine manifestation, il n'y aurait pas alors de raison, ainsi que le remarque Timothée Elure, de ne pas distinguer en lui sept natures, à savoir la chimique, la végétale, l'animale, la raisonnable, la spirituelle, l'angélique et la divine, cette dernière étant la plus significative et dominant les autres. Nous mettons l'accent sur le fait que les natures divine et humaine étaient indivisiblement unies en Christ; le résultat, cependant, n'en fut pas pour autant qu'elles devinrent une et même chose.
Eu égard au nombre, les natures n'étaient pas une mais deux; elles étaient toutefois si unies que, bien que nous les distinguions, elles ne sont pas distinctement différentes mais forment une unité en une seule personne. Par conséquent, nous ne pouvons plus dire que chaque nature subsiste en elle-même et accomplit des actes selon ce qui lui est propre, mais nous croyons que l'idée de l'une suscite l'idée de l'autre. La tentative des chalcédoniens de concevoir l'une à part de l'autre est aussi funeste que confondre le corps humain avec l'homme tout entier.
Il est incorrect de voir en Christ un homme qui devint Dieu;c'est Dieu qui s'est fait homme. II ne s'agit pas d'une conversion en chair et en os, mais de l'assomption de la chair et des os. Quand l'évangéliste dit: «Le Verbe s'est fait chair» (Jn I, 14), il se réfère à la nature divine participant à tout ce que le Christ expérimenta comme homme. Le Logos ne fut ni grandi ni diminué par l'incarnation; il resta impassible au milieu même de la Passion qu'il souffrit selon la chair. Bien que son humanité fût sujette à l'ignorance, il était omniscient; hors de sa chair il demeurait aussi omniprésent, et cependant il était tout entier devenu homme.
Le Verbe et l'humanité constituent une nature et, de la sorte, une union naturelle est établie. Sans perdre ses attributs originaux et particuliers, il s'approprie également les attributs humains qui, vu qu'il est leur sujet ou centre personnel, peuvent être considérés par lui comme siens. Les théologiens monophysites nient avec force que le Fils de Dieu effectue la moindre transformation de l'humain en divin ou quelque identification des deux.
La nature humaine ne s'est pas dissoute dans la divine, mais bien plutôt cette dernière fit sienne immédiatement la nature humaine, puisqu'elle existait dans la Vierge et fut transmise par elle. Le Verbe s'appropria la nature humaine avec ses capacités, ses lois et ses relations. Quand il la fit sienne, il permit à ses lois d'exercer un certain pouvoir sur lui.
Le Christ honora l'humanité qu'il assuma et éleva à sa divine substance. C'est ainsi que l'idée de rédemption exige la déification de la nature humaine du Christ. Mais, selon les chalcédoniens, l'humanité ne fut pas déifiée dans le Rédempteur, mais simplement unie à sa divinité par la personne. Par conséquent, comment une telle union, excluant la déification de la nature humaine, pourrait-elle avoir quelque effet ou valeur pour nous? Dès lors, en n'assignant pas de place à la theosis, la relation entre Dieu et l'homme n'est que morale en dernier ressort. Mais comment une relation morale peut-elle être une relation réelle?
Les exposés doctrinaux contenus dans les oeuvres des théologiens monophysites sont orientés vers la conservation d'un principe d'unité alors même qu'ils reconnaissent la diversité des prédicats, et visent à caractériser tous les actes et souffrances du Christ comme divins et humains à la fois en une union divino-humaine.
La conception de Léon et des chalcédoniens, comme on l'a vu, est l'inverse, puisqu'ils assignent une fonction à la nature divine et une autre à la nature humaine, même après l'union. Dieu et l'homme étaient vraiment en Christ une personne, une unité et, par conséquent, il faut rapporter à elle seule l'abaissement et l'exaltation à la fois.
En résumé, nous pouvons dire que les Eglises monophysites croient en une nature du Logos incarné. Elles proclament que le Christ est un, vrai Dieu et vrai homme, non homme en apparence, mais concret et réel, possédant en toute perfection la nature humaine aussi bien que la divine, unies en lui sans confusion et sans division ni changement, harmonieusement et ineffablement. Il souffrit la passion en son humanité, mais est immortel et non susceptible de souffrir en sa divinité.
Ces Eglises croient que, par l'incarnation, le Dieu-Logos s'est incorporé toute la nature humaine, tout en restant le même. Aucune transformation n'est survenue en lui, mais il a fait monter l'humanité dans l'unité de sa substance, sans rien perdre d'elle; au contraire, il a exalté l'humanité et l'a élevée à sa divine gloire.
En conclusion, nous aimerions citer l'Apologie que saint Nersès Shnorhali, l'illustre catholicos arménien du X Ile siècle, adressa à l'empereur byzantin Manuel 1er Comnène, qui prenait un vif intérêt aux questions théologiques :
«Nous confessons la Toute Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, divisée en trois personnes et unie en une nature et divinité. Le Père est non engendré, sans commencement, existant avec le temps; le Fils, engendré de la nature du Père, impassible, incorporel, existant avant le temps; le SaintEsprit, procédant du Père, non par génération comme le Fils, mais en émanant comme un fleuve d'une source; le tout d'une façon intelligible à Dieu seul et incompréhensible aux créatures.
Il n'y eut pas de temps où le Fils et l'Esprit n'étaient pas encore avec le Père; mais, de même qu'il fut toujours le Père et ne reçut pas ensuite le nom de la paternité, ainsi également le Fils fut toujours le Fils co-éternel du Père; et le Saint-Esprit fut toujours l'Esprit de Dieu, inséparable du Père et du Fils; il est une essence, une puissance, une volonté et une force créatrice en trois personnes. Il n'y a (en elles) ni grandeur ni petitesse, ni hauteur ni bassesse, ni supériorité ni infériorité, mais seulement une dignité, un service, une majesté de la Sainte Trinité consubstantielle, qui fit ex-nihilo toutes les créatures: les cieux et tout ce qui est céleste; la terre et tout ce qui est terrestre; les créatures visibles et invisibles qui furent créées au temps de la création.
En second lieu, l'Un de la Trinité, le Verbe, le Fils monogène du Père, par la volonté du Père et du Saint-Esprit, annoncé par l'Archange Gabriel, descendit dans les entrailles de la Vierge Marie, sans que sa nature divine incirconscrite ne quittât le sein du Père; prenant une partie du sang de la Très-Pure Vierge, faite de la côte d'Adam, il l'unit à sa divinité par une fusion inscrutable et ineffable. Il devint alors de deux natures parfaites, divine et humaine, en une personne parfaite immuable et indivisible; il ne perdit pas ses propriétés ni ne prit la grossière et complexe nature humaine en échange de la simple et non complexe nature divine; ni ne déchut la nature divine de sa simplicité éternelle en unissant la nature divine simple et incorporelle à la nature matérielle du corps, bien qu'il soit dit de l'indissoluble union que l'incorporel s'est fait chair et que le Verbe s'est matérialisé.
Ainsi le Verbe immatériel fusionne avec le corps, s'unit à notre nature humaine et la divinise par cette fusion et union, sans produire de changement ni d'altération dans
l'union à laquelle participent l'âme et le corps de l'homme. Même l'explication de cet exemple est inintelligible, car la vérité est supérieure à l'exemple, comme l'est l'analogie entre le créateur et la créature. D'une manière inconcevable, le Verbe unit notre nature à la sienne propre de telle façon que les natures divines et humaine restent inaltérées, non comme l'air et l'eau contenus dans un vase devenu vide après avoir été vidé, mais c'est par nature qu'il s'est uni incompréhensiblement, d'une union indivisible et sans confusion.
Christ prit la nature d'Adam, non celle que ce dernier avait sans pécher au paradis, mais celle qu'il reçut après le péché et la corruption. La Vierge Marie, de laquelle il prit chair , était de la nature peccamineuse d'Adam, et cette nature fut unie à la divine nature de Dieu; la peccamineuse devint non peccamineuse, et la corruptible devint exempte de la misérable corruption des passions, de même que les minéraux embrasés par le feu, leurs scories consumées et leur nature purifiée de toute corruption demeurent inconsumés. Son apparition fut immaculée, car sa naissance se fit de la Vierge immaculée, sans pollution; sa mort également fut sans corruption, parce que son corps, bien qu'au tombeau, ne subit pas de corruption. Par conséquent, il devait avoir été incorruptible durant la période qui s'écoula entre sa naissance et sa mort ...
Nous confessons le Christ comme Dieu et homme, mais nous n'introduisons pas la division dans ces termes, à Dieu ne plaise, parce qu'il souffrit lui-même et ne souffrit pas; en effet, par sa nature divine, il est immuable et impassible, mais en son corps humain il souffrit et mourut. En conséquence, ceux qui disent qu'il yen eut un qui souffrit et un autre qui ne souffrit pas, tombent dans l'erreur. Ainsi, ce ne fut personne d'autre que le Verbe qui souffrit et étreignit la mort dans son corps; car le même Verbe lui-même, qui est impassible et incorporel, consentit à devenir passible afin de sauver l'humanité par sa passion.
En effet, tout ce que la chair corporelle du Verbe souffrit appartenait au corps qui était joint au Verbe et devint extrêmement glorieux. Car c'était lui qui souffrait, et lui encore qui ne souffrait pas. Il souffrait en son corps parce qu'il était torturé, mais ne ressentait pas la souffrance en sa passion, car il était inséparable de son corps passible et, en tant que Verbe divin, en sa nature, il était inaccessible à la passion. Mais l'incorporel s'était joint inséparablement au corps passible que le Verbe revêtit, soulageant sa faiblesse ...
Nous disons une nature en Jésus-Christ - ni confondue, comme Eutychès l'enseignait, ni submergeant l'humanité, comme le disait Apollinaire, mais selon Cyrille d'Alexandrie qui, dans son mémoire contre Nestorius, établit qu'«une est la nature du Verbe incarné comme les Pères dirent». Cyrille entend par "Pères" Athanase et ceux qui le précédèrent.
Nous parlons, par conséquent, selon la tradition des Pères et non selon les opinions des hétérodoxes qui, en confessant une nature, rendent confuse, transforment et changent de plusieurs manières l'incarnation du Christ. Au lieu de dire une personne en Christ, comme vous le faites et comme nous le professons, nous disons une nature, ce qui n'est pas conforme aux conceptions hérétiques; les deux sont semblables.
Quand nous parlons du Christ, nous ne désignons pas seulement une qualité en lui, mais deux. Ce que nous avons établi quant à sa passion et à sa mort est dit aussi par Athanase, à savoir que Dieu le Verbe s'incarnant était impassible par nature, mais que l'incorporel était uni indivisiblement avec le corps passible. Quand nous disons une nature, nous entendons l'union indivisible et ineffable du Verbe avec la chair.
D'un autre côté, nous nous accordons avec ceux qui confessent deux natures, non divisées malgré Nestorius, et non confondues malgré les enseignements hétérodoxes d'Eutychès et d'Apollinaire, mais unies sans confusion ni division.
Par exemple, l'homme a un corps et une âme; les deux sont de différente nature, parce que l'une est céleste et l'autre terrestre, l'une est visible et l'autre invisible, l'une est temporelle et l'autre immortelle mais, après l'union, on dit que l'homme a une nature et non deux. Aucune confusion ne provient du fait de dire que l'homme a une nature. Nous n'estimons pas que l'homme soit seulement d'âme ou de chair, mais l'union des deux. Ainsi est-il dit que la nature du Christ est une, non confondue, quoiqu'il y ait deux natures ineffablement unies l'une à l'autre.
S'il n'en était pas ainsi, nous devrions alors considérer non seulement deux natures en Christ mais trois, à savoir deux natures humaines, l'âme et le corps, et une nature divine. Mais, selon les écrits des Pères, la dualité des divisions disparut après l'union. Par conséquent, si "une nature" est dite de l'indissoluble et indivisible union et non de la confusion, et si "deux natures" suppose qu'elles sont sans confusion, immuables et indivisibles, les deux expressions sont dans les bornes de l'orthodoxie ...
Nous disons que le Christ est Dieu et homme, consubstantiel à nous selon son humanité, consubstantiel au Père et à l'Esprit par sa divinité. Il est lui-même Dieu indivisible, céleste, simple, impassible et immortel en sa nature divine. Il est terrestre, extensible, passible et mortel en sa nature humaine.
Mais il n'est pas une personne et une autre personne comme le pensait Nestorius en disant que le corps est le temple du Verbe. Après l'union, la dualité disparut. De même que, parfois, les attributs divins du Très-Haut sont appliqués dans les Ecritures au corps, consubstantiel à nous, ainsi les noms du Christ relatifs à son économie sont rapportés par l'Apôtre à sa divinité, quand il dit: « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement» (Hébr 13, 8) .
Par hier, il entend la divinité éternelle qui était avec le Père; par aujourd'hui son incarnation; par demain et éternellement - son royaume sans fin. Si l'Apôtre avait eu connaissance de quelque division entre sa divinité et son humanité, il aurait dit: Dieu le Verbe hier, et Jésus-Christ aujourd'hui. Mais, ni l'Apôtre ni les Pères de l'Eglise n'indiquèrent une division après l'incarnation. Jean l'Evangéliste, en touchant le corps, entendait toucher le Verbe.
Il dit :
«Nos mains ont touché le Verbe de vie» (I Jn 1, 1) . De même, les propriétés particulières au corps sont rapportées à sa divinité, si bien que Dieu souffrit, Dieu fut crucifié, Dieu versa son sang, Dieu mourut, selon saint Grégoire le Théologien et les autres saints. Tout cela signifie l'union ineffable et l'indivisibilité du Verbe.
Nous avons montré ci-dessus que, dans l'union hypostatique, la nature substantielle et corporelle ne s'est pas changée en incorporelle et pure nature de Dieu, ni n'a perdu son volume, pas plus que la pure et incorporelle nature de Dieu, s'unissant à la nature de la chair, n'a changé ou altéré sa simplicité éternelle. Le vinaigre et le miel, comme l'eau et le vin, sont corrompus quand on les jette à la mer. Le mode d'union de la divinité et de l'humanité n'est pas tel. En effet, lorsque le vinaigre et le miel sont mélangés, ils se corrompent, étant matériels.
Mais le corps et l'incorporel fusionnent et s'unissent ineffablement; ils ne changent pas ni ne se mélangent l'un avec l'autre, pas plus que l'âme humaine et le corps. Ainsi, si cela se vérifie quant à la nature créée, combien plus glorieuse encore, et de beaucoup, devra-t-on estimer l'union de la nature du Créateur avec l'être de la créature».
Telle est la foi orthodoxe des Eglises monophysites, préservée et confessée durant quinze siècles. Ni le feu des Perses, ni le sabre des musulmans, ni les persécutions des Dyophysites, ni quelque autre pouvoir civil ou destructeur n'ont pu l'altérer ni la détruire.
Notes
1. KIDD (B.J.) : Histoire de /' Eglise, tome Ill, p. 202-203 (édition anglaise).
2. Voici ce que dit le professeur Adolphe HARNACK : «La honte s'attachant à ce concile [ de Chalcédoine] vient de ce que la grande majorité des évêques, qui pensait comme Cyrille et Dioscore, se laissa finalement imposer une formule qui était celle d'étrangers, de l'empereur et du pape, et qui ne correspondait pas à sa croyance. ... Les vues de la grande majorité des Pères assemblés à Chalcédoine ne s'accordaient ni avec celles de Léon ni avec celles de Flavien ... Ils ne souhaitaient rien au-delà de la ratification des Credo de Nicée et d'Ephèse tels que Cyrille les avait compris.» (Histoire du dogme, t. IV, p. 215-216, édition allemande).
Il est peut-être intéressant de mettre en parallèle avec ce texte d'Harnack les propos tenus à Paris en 1962 par le métropolitue syrojacobite des Elats-Unis et du Canada Mar Athanasios Y. Samuel à Mgr Georges Khouri-Sarkis, chorévêque de l'Eglise syrienne uniate:
«Vous, catholiques, vous avez rejeté le Ile concile d' Ephèse réuni en 449 sous la présidence du patriarche d' Alexandrie Dioscore. Les raisons que vous invoquez pour le rejet de ce concile: la pression faite sur les Pères conciliaires par les soldats en armes qui entouraient la salle de réunion. Nous, nous rejetons le Concile de Chalcédoine, pour les mêmes raisons. Croyez-vous sincèrement que les 130 Pères qui, à Ephèse, avaient proclamé qu'il n'y avait dans le Christ qu'une seule nature auraient, en moins de deux ans, changé complètement de doctrine, qu'ils se seraient conduits d'une façon aussi abjecte quand, à Chalcédoine, se jetant à genoux, suppliant qu' on leur pardonne, disant qu'on les avait trompés, criant plus fort que les autres pour demander la déposition de Dioscore, croyez-vous, dis-je, que des hommes, des évêques, auraient fait cela s'ils n'avaient pas senti peser sur leurs têtes le glaive d'un empereur autoritaire et tyrannique, le général Marcien?
« Non, dans ces sortes de conciles la voix du Saint-Esprit ne peut se faire entendre. Et les décisions de Chalcédoine n'ont pas plus de valeur à nos yeux que n'en ont, à vos yeux, celles de ce que vous appelez le" Brigandage d' Ephèse" . Avez-vous pensé au fait qu'à la suite de Chalcédoine la grande majorité des peuples ne parlant pas le grec s'opposa à ses décisions: Syriens, Arméniens, Coptes, Ethiopiens, et que la très grosse majorité des chrétiens de langue grecque adopta ses conclusions? En aurait-il été ainsi si chacun des évêques avait écouté la voix de sa conscience et celle du Saint-Esprit au lieu de faire bloc avec les tenants de Byzance ou les ennemis de Byzance?
Mais laissons tout cela de côté. Je veux espérer que l'époque des controverses, des dialogues de sourds, est définitivement révolue.» (in L'Orient Syrien, no34-35, 1964, pp. 261-262) - NDLR.
3. L' "Epistola dogmatica" écrite en 449 par le pape Léon 1er à Flavien, patriarche de Constantinople.
4. Les Monophysites ne doivent pas être confondus avec les Eutychiens.Les premiers confessent la doctrine de S. Cyrille approuvée au concile général d'Ephèse que nous relatons. Les Eglises monophysites sont les Eglises nationales d'Annénie, d'Egypte, d'Ethiopie et de Syrie.
5. DRIVER (G.R.) et HODGSON (L.) : Le livre d' Héraclide, p. 159, 209, 215,237.
6. Le Tome de Léon, édité par BLAKENEY (E.H.), p. 31.
7. BLAKENEY, op. cit. p. 91.
8. " " p. 29.
9. " " p. 160, 166-167, 209.
10. " " p.31.
11. HARNACK (A.) : Histoire du dogme, t. IV, p. 179.
12. " " " p. 222.
13. " " " p. 223.
14. SCHWEITZER (A.) : La quête du Jésus historique, p.3-4 (édition allemande).
15. " Expository Times, octobre 1905-janvier 1906, p. 10.
16. MACKINTOSH (H.R.) : La doctrine de la personne du Christ, p. 294-296 (édition anglaise).
![]()
http://eocf.free.fr/monophysisme.htm